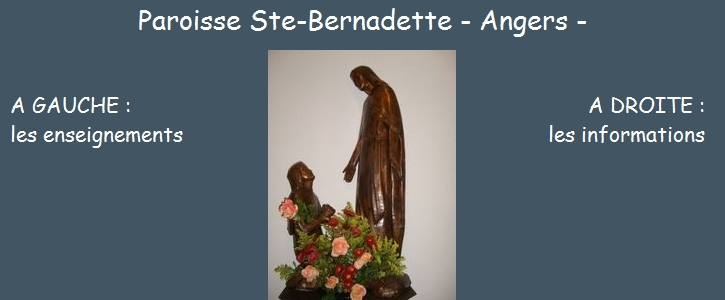33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
15 novembre 2009
Dans quinze jours, le dimanche 29 novembre, nous célébrerons le premier dimanche de l’Avent. Ce sera le début de la nouvelle année liturgique. Ce qui veut dire que nous approchons de la fin d’une année liturgique. Nous sommes donc dans le temps où l’Eglise, chaque année, nous fait relire des textes concernant la fin des temps, la fin du monde, et de ce fait la fin de notre vie personnelle.
Ces chapitres des Ecritures sont bien différents des paraboles, souvent pittoresques, employées par Jésus pour faire comprendre par des images simples et un langage familier les réalités de la vie spirituelle et le comportement que nous devons corriger pour devenir de meilleurs chrétiens.
Même s’il y a une comparaison avec le figuier et ses nouvelles feuilles, qui donnent une image concrète et fraiche, reconnaissons que ces chapitres sont particulièrement austères et sévères. Et pourtant ils annoncent la venue du Fils de l’Homme, vainqueur du péché et de la mort.
Comme le plus souvent, la première lecture et l’Evangile se répondent assez précisément. Entre les deux, la lettre aux Hébreux fait le lien entre l’Ancien et le Nouveau Testaments. Dans l’Ancienne Alliance, les prêtres offraient chaque jour, debout, avec respect, les mêmes sacrifices « qui n’ont jamais pu enlever les péchés. » Jésus-Christ au contraire s’offrant lui-même, par son unique sacrifice supprime tous les péchés. Il a accompli sa mission sur terre. Et, comme nous le redisons chaque dimanche dans notre Profession de Foi, le Symbole des Apôtres, « il s’est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant », expression imagée qui signifie la divinité du Fils.
« Il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui sa sainteté. » C’est au passé car le sacrifice du Christ est accompli. Mais il appartient à chacun d’actualiser en lui-même ce sacrifice, de s’y associer pleinement. C’est la raison d’être de la messe, qui rend présent ce sacrifice, et des sacrements qui en découlent.
Revenons au Livre de Daniel, qui met en jeu Michel le chef de l’armée céleste, qui va présider à la délivrance finale. Les textes prophétiques sont toujours difficiles à interpréter, car ils superposent le temps présent et l’au-delà, qui échappe à la chronologie. Il ne faut donc pas chercher une annonce datée de la fin du monde.
Les termes utilisés par Daniel correspondent à la représentation imagée de son époque. C’est ainsi que pour lui dans le ciel sont tenus à jour les registres qui contiennent les noms des vivants, destinés à devenir les membres de la Nouvelle Jérusalem.
« Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront. » C’est déjà une annonce de la résurrection. Dieu triomphe du dernier ennemi, la mort personnifiée, et il lui arrache les fidèles qu’elle avait indûment engloutis.
Dans les textes les plus anciens, nous disent les spécialistes, le thème de la résurrection était compris d’une façon symbolique et collective. La promesse de la résurrection individuelle est la réponse prophétique au problème posé par la mort des martyrs.
Ces paroles transmises par Daniel sont empreintes d’une grande espérance. La promesse de la résurrection, pour lui, vise en premier lieu les chefs spirituels du peuple, les « sages » qui l’ont maintenu dans la vraie foi : Dieu seul justifie, mais par leur enseignement ils ont conduit la multitude vers la justice, et vers la vie éternelle, qui n’est pas directement décrite. Mais la lumière du firmament et des étoiles sert de symbole pour évoquer la transfiguration des ressuscités.
« Restez éveillés et priez en tout temps – nous disait le verset de l’Alléluia – ainsi vous serez jugés dignes de paraître debout devant le Fils de l’homme.
C’est la leçon que nous avons à retenir de ce dimanche, qui nous invite à partager les sentiments exprimés par le psaume : « Mon cœur exulte, mon âme est en fête… Tu ne peux m’abandonner à la mort… Tu m’apprends le chemin de la vie… Devant ta face, Seigneur, débordement de joie ! »
Amen
Père Jean Rouillard
17 novembre 2009
09 novembre 2009
Homélie du 08 novembre 2009
Homélie du 32ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B
Connaissez-vous la luminothérapie ? On l’utilise dans le traitement de la dépression saisonnière et des troubles du sommeil ; il s’agit d’une projection de lumière censée stopper la production de mélatonine (l’hormone qui nous fait dormir) et stimuler la production de sérotonine (l’hormone qui nous donne la pêche !). Je ne me lance pas dans le débat médical, je souligne simplement le principe, qui est simple et qui se repose sur l’expérience : vous conviendrez avec moi que ces jours-ci, les jours raccourcissent, il pleut, les feuilles tombent … tous les ingrédients sont là pour que nous ayons le moral dans les chaussettes …ajoutez à cela un ou deux journaux télévisés et une épreuve dans votre famille, et le tour est joué ! Et donc, il est bien vrai que quand il fait froid, quand il pleut, quand il fait sombre, il est plus difficile d’être joyeux !
Or, il y a deux sortes de froid, il y a deux sortes de pluies, il y a deux sortes d’obscurité : le froid matériel, la pluie matérielle, l’obscurité matérielle et le « froid » spirituel, incarné par la « sorcière blanche » de « Narnia », cette « obscurité » spirituelle, où nous ne savons plus ce qui est bien vrai, beau, et enfin cette « pluie » du cœur que Verlaine a si bien décrite …
Je propose donc, en ce mois de novembre, une « luminothérapie spirituelle » : elle consiste à s’exposer au soleil de la présence de Dieu, par la prière. Je pense à l’événement désormais régulier des 24h d’adoration (le 28 novembre prochain), mais je pense aussi à quelque chose de régulier, sans quoi on ne pourrait pas parler de « thérapie » …
De la sorte, nous pourrions produire (pardon pour le terme) de la « Dieutonine », qui serait en nous le principe de la joie, non pas une joie superficielle, qui dépende du temps ou des aléas de la vie, mais une joie profonde, une lumière permanente, qui nous fait traverser l’hiver victorieusement, l’hiver matériel et les hivers spirituels …
Dieu est une richesse que personne ne peut prendre, celui qui a Dieu a tout, il n’a besoin de rien d’autre (« que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie, celui qui a Dieu possède tout, seul Dieu suffit », disait Sainte Thérèse de Jésus )
Jean 16 "La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais, quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre coeur se réjouira ; et votre joie, personne ne vous l'enlèvera."
Je ne saurais décrire avec précision ce que j’éprouvais à chaque fois que, à Rome, j’entrais dans le réfectoire des petites sœurs de l’Agneau (communauté nouvelle née en France d’inspiration dominicaine), réfectoire qui respirait à la fois la pauvreté et la joie. Je sentais bien qu’il y avait ce cocktail de joie et de pauvreté, mais je ne me l’expliquais pas bien, pendant le temps de mon séminaire. Aujourd’hui, je le comprends mieux : la pauvreté sans Dieu est une misère double, la pauvreté avec Dieu pour richesse est plus puissante que la richesse même et elle provoque une joie indestructible. Jean 15 : « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie ! »
Si nous pouvions quitter cette vie en connaissant cette joie et en la portant autour de nous, alors nous nous aurions réussi notre vie, et c’est bien ce que les saints ont fait : le mois de novembre est le mois des saints, il commence par la Toussaint et il est une invitation à la joie en compagnie de Dieu.
Mais la luminothérapie spirituelle ne suffit pas, il est bon de connaître ce que St Ambroise appelait « les trois morts » : en étudiant la Bible, il en déduit qu'il existe trois types de mort :
- la séparation de l’âme et du corps
- la mort au péché, qui consiste à faire mourir dès cette vie tout ce qui a goût de mort, tout ce qui s’oppose à Dieu, formalisé dans les dix commandements
- la mort spirituelle, celle qui consiste, au contraire, tandis qu’on est encore vivant, à être mort à l’intérieur, par l’abandon volontaire de Dieu. C’est de cette mort-là que Jésus parlait lorsqu’il disait « laisse les morts enterrer leurs morts ».
St Paul enseigne en effet que c’est le péché qui fit entrer la mort dans le monde, voilà pourquoi aujourd’hui, la mort fait partie de la nature, de la nature blessée de l’homme et les deux autres morts s’annulent l’une l’autre dans une vie qui sera conforme au Christ
Tous saints !!! C’est le cri de la Toussaint, puissant appel à devenir des êtres lumineux ! Invoquons la Vierge Marie, sainte entre tous, pour qu’elle nous guide sur ce chemin de lumière.
Or, il y a deux sortes de froid, il y a deux sortes de pluies, il y a deux sortes d’obscurité : le froid matériel, la pluie matérielle, l’obscurité matérielle et le « froid » spirituel, incarné par la « sorcière blanche » de « Narnia », cette « obscurité » spirituelle, où nous ne savons plus ce qui est bien vrai, beau, et enfin cette « pluie » du cœur que Verlaine a si bien décrite …
Je propose donc, en ce mois de novembre, une « luminothérapie spirituelle » : elle consiste à s’exposer au soleil de la présence de Dieu, par la prière. Je pense à l’événement désormais régulier des 24h d’adoration (le 28 novembre prochain), mais je pense aussi à quelque chose de régulier, sans quoi on ne pourrait pas parler de « thérapie » …
De la sorte, nous pourrions produire (pardon pour le terme) de la « Dieutonine », qui serait en nous le principe de la joie, non pas une joie superficielle, qui dépende du temps ou des aléas de la vie, mais une joie profonde, une lumière permanente, qui nous fait traverser l’hiver victorieusement, l’hiver matériel et les hivers spirituels …
Dieu est une richesse que personne ne peut prendre, celui qui a Dieu a tout, il n’a besoin de rien d’autre (« que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie, celui qui a Dieu possède tout, seul Dieu suffit », disait Sainte Thérèse de Jésus )
Jean 16 "La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais, quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre coeur se réjouira ; et votre joie, personne ne vous l'enlèvera."
Je ne saurais décrire avec précision ce que j’éprouvais à chaque fois que, à Rome, j’entrais dans le réfectoire des petites sœurs de l’Agneau (communauté nouvelle née en France d’inspiration dominicaine), réfectoire qui respirait à la fois la pauvreté et la joie. Je sentais bien qu’il y avait ce cocktail de joie et de pauvreté, mais je ne me l’expliquais pas bien, pendant le temps de mon séminaire. Aujourd’hui, je le comprends mieux : la pauvreté sans Dieu est une misère double, la pauvreté avec Dieu pour richesse est plus puissante que la richesse même et elle provoque une joie indestructible. Jean 15 : « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie ! »
Si nous pouvions quitter cette vie en connaissant cette joie et en la portant autour de nous, alors nous nous aurions réussi notre vie, et c’est bien ce que les saints ont fait : le mois de novembre est le mois des saints, il commence par la Toussaint et il est une invitation à la joie en compagnie de Dieu.
Mais la luminothérapie spirituelle ne suffit pas, il est bon de connaître ce que St Ambroise appelait « les trois morts » : en étudiant la Bible, il en déduit qu'il existe trois types de mort :
- la séparation de l’âme et du corps
- la mort au péché, qui consiste à faire mourir dès cette vie tout ce qui a goût de mort, tout ce qui s’oppose à Dieu, formalisé dans les dix commandements
- la mort spirituelle, celle qui consiste, au contraire, tandis qu’on est encore vivant, à être mort à l’intérieur, par l’abandon volontaire de Dieu. C’est de cette mort-là que Jésus parlait lorsqu’il disait « laisse les morts enterrer leurs morts ».
St Paul enseigne en effet que c’est le péché qui fit entrer la mort dans le monde, voilà pourquoi aujourd’hui, la mort fait partie de la nature, de la nature blessée de l’homme et les deux autres morts s’annulent l’une l’autre dans une vie qui sera conforme au Christ
Tous saints !!! C’est le cri de la Toussaint, puissant appel à devenir des êtres lumineux ! Invoquons la Vierge Marie, sainte entre tous, pour qu’elle nous guide sur ce chemin de lumière.
P. Emmanuel d'Andigné
04 novembre 2009
Homélie du 1er Novembre - Toussaint 2009
Homélie de la fête de tous les saints
Cela signifie que l’on aurait pu traduire la fameuse béatitude (certains l’ont fait) par « heureux ceux qui prennent le deuil, ils seront consolés … »
On sait bien, en effet, que la Toussaint fait penser tout le monde à la question de la mort, eh bien l’Evangile de la Toussaint n’est pas seulement là pour nous montrer que la sainteté consiste à vivre conformément aux Béatitudes (c’est une bonne chose de le savoir …), mais aussi une puissante annonce de la résurrection, et que toutes les peines d’ici-bas, dont la mort est sans doute la reine, je cite « sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous » (Rm 8,18)
Mais je ne quitte pas la fête de tous les saints, en vous faisant un premier rapport de voyage de mon court séjour à Taizé, avec quelques centaines de lycéens, cette semaine : je ne m’attarderai que sur deux toutes petites choses
Cette semaine à Taizé, il y a eu une canonisation ! En effet, au cours d’une conversation entre jeunes, l’une d’eux déclara : « Frère Roger, puisqu’il est saint, … »
On sait bien que, objectivement, il est impossible de le canoniser, puisqu’il n’était pas catholique, mais je retiens de cette « canonisation du cœur » une certaine définition de la sainteté et cette définition s’inspire de la vie de cet homme : la sainteté, c’est de l’œcuménisme intérieur. Le saint, c’est sans doute quelqu’un d’unifié, il n’y a pas deux personnages en lui, il n’y en a qu’un. Cela produit deux effets en lui : une grande paix intérieure, et un rayonnement spirituel qui n’échappe à personne.
Comme vous le savez, comme vous l’avez compris, le pontificat du Pape Benoît XVI est très fortement marqué par l’œcuménisme . En effet, le jour de son élection, il prononça une parole qui passa pratiquement inaperçue, mais que certains ont saisi comme une allusion, en fait très claire, à l’œcuménisme : « Andiamo avanti ! » Quelques années auparavant, le Cardinal Ratzinger avait expliqué, dans son livre « voici quel est notre Dieu » que cette expression convenait particulièrement aux grands oecuménistes …
L’histoire a donné raison à ceux qui avait saisi l’allusion, puisque le Saint-Père multiplie, depuis 2005, les gestes dans toutes directions possibles, afin de surmonter les divisions de l’unique Eglise du Christ. Et voici ce qu’il déclara dès 1982 : « mon diagnostic sur les rapports entre l’Orient et l’Occident dans l’Eglise est le suivant : une unité ecclésiale est théologiquement possible en principe entre l’Orient et l’Occident, mais elle n’est pas encore assez préparée spirituellement, et donc, pratiquement, pas encore mûre »
Cela signifie que la recherche de l’unité doit être préparée par « l’œcuménisme intérieur », à savoir la sainteté !
Et lorsque les jeunes se penchent un peu sur eux-mêmes, en particulier dans la préparation du sacrement du pardon, ils finissent par découvrir que leur être est comme « éclaté » par mille désirs, mille directions contradictoires, mille gadgets électroniques et découvrent l’extraordinaire simplicité de Dieu dans une communauté comme Taizé ou dans n’importe quel monastère.
Les divisions dans l’Eglise ne sont que le reflet de nos divisions intérieures, que la fréquentation de Dieu contribue à éliminer.
Je me souviendrai toute ma vie de la question que le cardinal Lustiger nous avait posée, en 1997, sur le champ de Mars, pour l’ouverture des JMJ de Paris : « quel est votre désir ? ». « Quel est votre désir ? » au singulier ! Il faisait appel à ce qu’il y a de plus profond en nous et non aux mille sollicitations qui dispersent notre être. Et ceci n’est pas réservé à la jeunesse …
A tous ceux qui, comme nous, pourraient être découragés à l’idée de se lancer dans cette unifcation un peu exceptionnelle que l’on voit chez les saints, le curé d’Ars disait : « les saints n’ont pas toujours bien commencé, mais ils ont toujours bien terminé »
Parole encourageante, pour que nous recommencions, aujourd’hui, à unifier notre être pour l’orienter vers Dieu.
A propos de parole encourageante, j’ai relevé une partie de l’enseignement d’un frère de Taizé qui parlait des béatitudes, justement, et qui faisait remarquer aux jeunes que le tout début de l’enseignement de Jésus (les béatitudes) était un encouragement, suivi d’ailleurs par un autre encouragement : « vous êtes le sel de la Terre »
Le curé, d’Ars, encore lui, disait à l’envi qu’il fallait passer plus de temps à encourager le bien qu’à dénoncer le mal : mal qu’il dénonçait abondamment, bien qu’il soulignait encore plus …
Nous avons là une indication sur la pédagogie de Dieu à notre égard et donc sur celle que nous devons avoir dans nos relations avec les jeunes et les enfants avec, donc, ce léger déséquilibre en faveur de l’encouragement.
Heureux sommes-nous, en effet, de préparer un bonheur éternel avec Dieu et d’éprouver déjà un peu ce bonheur, dans la foi, dans l’Espérance et dans la charité !
Avant de vous faire un rapport de voyage de mon escapade à Taizé, je voudrais vous signaler un mot grec que la traduction liturgique a choisi de rendre par le mot « pleurer », penthéo, mais il est bon de savoir que ce mot, dans le Nouveau Testament désigne dans 9 cas sur 14 (tout de même …) la situation précise du deuil ; les 5 autres cas parlent de tristesse sans précision, tout en sachant qu’il pourrait s’agir du deuil …
Cela signifie que l’on aurait pu traduire la fameuse béatitude (certains l’ont fait) par « heureux ceux qui prennent le deuil, ils seront consolés … »
On sait bien, en effet, que la Toussaint fait penser tout le monde à la question de la mort, eh bien l’Evangile de la Toussaint n’est pas seulement là pour nous montrer que la sainteté consiste à vivre conformément aux Béatitudes (c’est une bonne chose de le savoir …), mais aussi une puissante annonce de la résurrection, et que toutes les peines d’ici-bas, dont la mort est sans doute la reine, je cite « sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous » (Rm 8,18)
Mais je ne quitte pas la fête de tous les saints, en vous faisant un premier rapport de voyage de mon court séjour à Taizé, avec quelques centaines de lycéens, cette semaine : je ne m’attarderai que sur deux toutes petites choses
Cette semaine à Taizé, il y a eu une canonisation ! En effet, au cours d’une conversation entre jeunes, l’une d’eux déclara : « Frère Roger, puisqu’il est saint, … »
On sait bien que, objectivement, il est impossible de le canoniser, puisqu’il n’était pas catholique, mais je retiens de cette « canonisation du cœur » une certaine définition de la sainteté et cette définition s’inspire de la vie de cet homme : la sainteté, c’est de l’œcuménisme intérieur. Le saint, c’est sans doute quelqu’un d’unifié, il n’y a pas deux personnages en lui, il n’y en a qu’un. Cela produit deux effets en lui : une grande paix intérieure, et un rayonnement spirituel qui n’échappe à personne.
Comme vous le savez, comme vous l’avez compris, le pontificat du Pape Benoît XVI est très fortement marqué par l’œcuménisme . En effet, le jour de son élection, il prononça une parole qui passa pratiquement inaperçue, mais que certains ont saisi comme une allusion, en fait très claire, à l’œcuménisme : « Andiamo avanti ! » Quelques années auparavant, le Cardinal Ratzinger avait expliqué, dans son livre « voici quel est notre Dieu » que cette expression convenait particulièrement aux grands oecuménistes …
L’histoire a donné raison à ceux qui avait saisi l’allusion, puisque le Saint-Père multiplie, depuis 2005, les gestes dans toutes directions possibles, afin de surmonter les divisions de l’unique Eglise du Christ. Et voici ce qu’il déclara dès 1982 : « mon diagnostic sur les rapports entre l’Orient et l’Occident dans l’Eglise est le suivant : une unité ecclésiale est théologiquement possible en principe entre l’Orient et l’Occident, mais elle n’est pas encore assez préparée spirituellement, et donc, pratiquement, pas encore mûre »
Cela signifie que la recherche de l’unité doit être préparée par « l’œcuménisme intérieur », à savoir la sainteté !
Et lorsque les jeunes se penchent un peu sur eux-mêmes, en particulier dans la préparation du sacrement du pardon, ils finissent par découvrir que leur être est comme « éclaté » par mille désirs, mille directions contradictoires, mille gadgets électroniques et découvrent l’extraordinaire simplicité de Dieu dans une communauté comme Taizé ou dans n’importe quel monastère.
Les divisions dans l’Eglise ne sont que le reflet de nos divisions intérieures, que la fréquentation de Dieu contribue à éliminer.
Je me souviendrai toute ma vie de la question que le cardinal Lustiger nous avait posée, en 1997, sur le champ de Mars, pour l’ouverture des JMJ de Paris : « quel est votre désir ? ». « Quel est votre désir ? » au singulier ! Il faisait appel à ce qu’il y a de plus profond en nous et non aux mille sollicitations qui dispersent notre être. Et ceci n’est pas réservé à la jeunesse …
A tous ceux qui, comme nous, pourraient être découragés à l’idée de se lancer dans cette unifcation un peu exceptionnelle que l’on voit chez les saints, le curé d’Ars disait : « les saints n’ont pas toujours bien commencé, mais ils ont toujours bien terminé »
Parole encourageante, pour que nous recommencions, aujourd’hui, à unifier notre être pour l’orienter vers Dieu.
A propos de parole encourageante, j’ai relevé une partie de l’enseignement d’un frère de Taizé qui parlait des béatitudes, justement, et qui faisait remarquer aux jeunes que le tout début de l’enseignement de Jésus (les béatitudes) était un encouragement, suivi d’ailleurs par un autre encouragement : « vous êtes le sel de la Terre »
Le curé, d’Ars, encore lui, disait à l’envi qu’il fallait passer plus de temps à encourager le bien qu’à dénoncer le mal : mal qu’il dénonçait abondamment, bien qu’il soulignait encore plus …
Nous avons là une indication sur la pédagogie de Dieu à notre égard et donc sur celle que nous devons avoir dans nos relations avec les jeunes et les enfants avec, donc, ce léger déséquilibre en faveur de l’encouragement.
Heureux sommes-nous, en effet, de préparer un bonheur éternel avec Dieu et d’éprouver déjà un peu ce bonheur, dans la foi, dans l’Espérance et dans la charité !
P. Emmanuel d'Andigné
21 octobre 2009
Homélie du 18 Octobre 2009
Homélie du 29ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Mercredi, j’ai eu la chance de faire un pèlerinage au Mont Saint-Michel avec des lycéens. Nous avons parlé de l’appel à la vie religieuse et à la vie sacerdotale et j’ai tenu à aborder les deux questions qui souvent posent problème à notre époque, à savoir : le célibat des prêtres et l’ordination réservée aux hommes (j’espère qu’on prendra le temps de traiter ces questions au cours de l’année sacerdotale !!!)
Après mon intervention, j’ai eu une longue conversation avec quelques lycéens, et en creusant avec eux, j’ai eu l’occasion de débusquer ce qui me paraît une des origines du problèmes, et l’origine est tellement lointaine
qu’on ne voit plus où cela remonte …
Une fois de plus, l’Evangile nous donne la clé : le pouvoir, c’est la question du pouvoir qui finalement installe en nous une façon qui n’est pas juste d’aborder le problème de savoir qui a droit ou non à l’ordination ( « accorde-nous de siéger, l’un à ta droite … »).
On considère spontanément, et c’est un peu normal puisque c’est ainsi dans de nombreux autres domaines, le sacerdoce comme un instrument de pouvoir, et il est vrai que, comme son nom l’indique le prêtre peut faire des choses, il a donc un pouvoir, et que celui qui ne peut pas faire les mêmes choses n’a pas le même pouvoir …
Il y a donc comme deux niveaux dans le pouvoir : le premier niveau qui est la capacité de faire quelque chose, et les devoirs qui y sont liés, et l’autre qui l’utilisation de cette capacité pour un usage personnel, comme une arme de domination. On franchit la frontière entre ces deux régions de l’âme en raison du péché fondamental : l’orgueil. Le livre de la Genèse a décrit admirablement cette maladie spirituelle, « vous serez comme des dieux », comme Dieu qui est tout-puissant … Il peut tout, il a tous les pouvoirs, ne voudriez-vous pas être comme Dieu ?
Dieu ne manque pas d’humour, d’avoir fait en sorte que le modèle des prêtres, l’un des meilleurs prêtres que l’histoire ait porté, le Curé d’Ars, soit un ignorant, qui parlait mal et le français et le latin, car sa langue était plutôt le patois, et d’ailleurs la patronne de notre paroisse, par exemple, partage avec lui cette caractéristique de mieux parler patois que français …
A propos du pouvoir des prêtres, il me semble que l’on peut dire trois choses :
la première, c’est que lorsque Jésus inventa les prêtres (si vous me passez l’expression), il prit soin d’en faire d’abord des diacres, en leur lavant les pieds pour leur faire comprendre que le douanier qui empêche l’homme de franchir la frontière entre le simple pouvoir (celui qui consiste à pouvoir faire quelque chose) et le pouvoir orgueilleux, c’est le service. Nous devons faire en sorte que le sens du service purifie la soif de domination que le péché met dans notre cœur.
En toute logique, donc, lorsque l’Eglise ordonne un prêtre, elle prend toujours soin, d’abord, d’en faire un diacre, un serviteur, comme pour le prévenir et le soumettre à un test : es-tu capable de servir, ou veux-tu te servir ? …
La seconde chose, c’est que Jésus prévient ses disciples que ceux qui le suivront de près sur le chemin de sa gloire (ceux-là même qui demandaient de siéger à sa droite et à sa gauche !) devront lui emboîter le pas dans sa passion auparavant : la « coupe » dont Jésus parle est la même que celle dont il parlera un peu plus tard le jeudi saint, et c’est bien sûr la passion et la croix. Celui qui suit Jésus et qui s’en trouve honoré doit savoir qu’i n’est pas plus grand que son maître et qu’il connaîtra des tourments semblables.
Enfin, pour revenir à la question des hommes et des femmes quant à l’ordination, le Pape Jean-Paul II, dans une magnifique note sur ce sujet (« ordinatio sacerdotalis ») rappelle que personne n’a le droit à l’ordination, pas plus un homme qu’une femme, ce n’est jamais un droit, ou une revendication, c’est un appel, dont les règles ont été fixées par Jésus, et dont Jésus reste le maître encore aujourd’hui.
Jésus n’a réuni que des hommes autour de lui, ce jour-là, lorsqu’il inventa les prêtres, faisant un choix très clair et aussi très libre : on pense facilement aujourd’hui, un peu naïvement, que si Jésus avait vécu à notre époque, il aurait agi différemment, mais ça ne résiste pas à l’analyse : il n’a cessé, pendant trois ans, de s’asseoir sur toutes les conventions étriquées de son époque… on imagine mal comment, la veille de sa mort, il aurait pu craindre une convention de plus, et n’appeler que des hommes pour avoir la paix avec son entourage (ça ne tient pas debout) …
En outre, nous sommes en train de parler du Fils de Dieu, libre s’il en est, parfaitement libre, y compris libre par rapport à la façon dont le pouvoir s’exerçait à l’époque, de sorte que son choix avait des profondeurs que nous ne connaîtrons jamais bien ici-bas car nous considérons inconsciemment le sacerdoce comme une façon de dominer et non comme un lieu de service …
Lorsque le Pape Jean-Paul abordait cette question, il terminait son intervention en adressant aux femmes une interpellation, que je résume ainsi : quelle est l’originalité de votre vocation ? Qu’avez-vous que les hommes n’ont pas ? Quel est votre pouvoir, dans le sens : quelles sont les capacités que Dieu a déposées en vous et quel est votre génie propre ?
Il ne faudrait pas que orgueil nous oblige à faire de l’homme un modèle pour la femme, un modèle qu’il faudrait égaler, car homme et femme ont tous deux même modèle, Dieu, qui n’est ni un homme ni une femme. Et ce que Dieu veut, c’est l’épanouissement de chacun de ses enfants, plutôt qu’une équation sociale.
Tournons vers la Vierge Marie, accomplissement éminent d’une vocation, avec les mots du même Jean-Paul II dans Redemptoris Missio :
Toute l'Eglise est invitée à vivre plus intensément le mystère du Christ, en collaborant dans l'action de grâce à l'œuvre du salut. Elle le fait avec Marie et comme Marie, sa mère et son modèle. Marie est le modèle de l'amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Eglise, travaillent à la régénération des hommes. C'est pourquoi, « soutenue par la présence du Christ [...], l'Eglise marche au cours du temps vers la consommation des siècles et va à la rencontre du Seigneur qui vient; mais sur ce chemin [...], elle progresse en suivant l'itinéraire accompli par la Vierge Marie »177.
C'est à la « médiation de Marie, tout orientée vers le Christ et tendue vers la révélation de sa puissance salvifique »178, que je confie l'Eglise et en particulier ceux qui se consacrent à la mise en œuvre du précepte missionnaire dans le monde d'aujourd'hui"
Après mon intervention, j’ai eu une longue conversation avec quelques lycéens, et en creusant avec eux, j’ai eu l’occasion de débusquer ce qui me paraît une des origines du problèmes, et l’origine est tellement lointaine
qu’on ne voit plus où cela remonte …
Une fois de plus, l’Evangile nous donne la clé : le pouvoir, c’est la question du pouvoir qui finalement installe en nous une façon qui n’est pas juste d’aborder le problème de savoir qui a droit ou non à l’ordination ( « accorde-nous de siéger, l’un à ta droite … »).
On considère spontanément, et c’est un peu normal puisque c’est ainsi dans de nombreux autres domaines, le sacerdoce comme un instrument de pouvoir, et il est vrai que, comme son nom l’indique le prêtre peut faire des choses, il a donc un pouvoir, et que celui qui ne peut pas faire les mêmes choses n’a pas le même pouvoir …
Il y a donc comme deux niveaux dans le pouvoir : le premier niveau qui est la capacité de faire quelque chose, et les devoirs qui y sont liés, et l’autre qui l’utilisation de cette capacité pour un usage personnel, comme une arme de domination. On franchit la frontière entre ces deux régions de l’âme en raison du péché fondamental : l’orgueil. Le livre de la Genèse a décrit admirablement cette maladie spirituelle, « vous serez comme des dieux », comme Dieu qui est tout-puissant … Il peut tout, il a tous les pouvoirs, ne voudriez-vous pas être comme Dieu ?
Dieu ne manque pas d’humour, d’avoir fait en sorte que le modèle des prêtres, l’un des meilleurs prêtres que l’histoire ait porté, le Curé d’Ars, soit un ignorant, qui parlait mal et le français et le latin, car sa langue était plutôt le patois, et d’ailleurs la patronne de notre paroisse, par exemple, partage avec lui cette caractéristique de mieux parler patois que français …
A propos du pouvoir des prêtres, il me semble que l’on peut dire trois choses :
la première, c’est que lorsque Jésus inventa les prêtres (si vous me passez l’expression), il prit soin d’en faire d’abord des diacres, en leur lavant les pieds pour leur faire comprendre que le douanier qui empêche l’homme de franchir la frontière entre le simple pouvoir (celui qui consiste à pouvoir faire quelque chose) et le pouvoir orgueilleux, c’est le service. Nous devons faire en sorte que le sens du service purifie la soif de domination que le péché met dans notre cœur.
En toute logique, donc, lorsque l’Eglise ordonne un prêtre, elle prend toujours soin, d’abord, d’en faire un diacre, un serviteur, comme pour le prévenir et le soumettre à un test : es-tu capable de servir, ou veux-tu te servir ? …
La seconde chose, c’est que Jésus prévient ses disciples que ceux qui le suivront de près sur le chemin de sa gloire (ceux-là même qui demandaient de siéger à sa droite et à sa gauche !) devront lui emboîter le pas dans sa passion auparavant : la « coupe » dont Jésus parle est la même que celle dont il parlera un peu plus tard le jeudi saint, et c’est bien sûr la passion et la croix. Celui qui suit Jésus et qui s’en trouve honoré doit savoir qu’i n’est pas plus grand que son maître et qu’il connaîtra des tourments semblables.
Enfin, pour revenir à la question des hommes et des femmes quant à l’ordination, le Pape Jean-Paul II, dans une magnifique note sur ce sujet (« ordinatio sacerdotalis ») rappelle que personne n’a le droit à l’ordination, pas plus un homme qu’une femme, ce n’est jamais un droit, ou une revendication, c’est un appel, dont les règles ont été fixées par Jésus, et dont Jésus reste le maître encore aujourd’hui.
Jésus n’a réuni que des hommes autour de lui, ce jour-là, lorsqu’il inventa les prêtres, faisant un choix très clair et aussi très libre : on pense facilement aujourd’hui, un peu naïvement, que si Jésus avait vécu à notre époque, il aurait agi différemment, mais ça ne résiste pas à l’analyse : il n’a cessé, pendant trois ans, de s’asseoir sur toutes les conventions étriquées de son époque… on imagine mal comment, la veille de sa mort, il aurait pu craindre une convention de plus, et n’appeler que des hommes pour avoir la paix avec son entourage (ça ne tient pas debout) …
En outre, nous sommes en train de parler du Fils de Dieu, libre s’il en est, parfaitement libre, y compris libre par rapport à la façon dont le pouvoir s’exerçait à l’époque, de sorte que son choix avait des profondeurs que nous ne connaîtrons jamais bien ici-bas car nous considérons inconsciemment le sacerdoce comme une façon de dominer et non comme un lieu de service …
Lorsque le Pape Jean-Paul abordait cette question, il terminait son intervention en adressant aux femmes une interpellation, que je résume ainsi : quelle est l’originalité de votre vocation ? Qu’avez-vous que les hommes n’ont pas ? Quel est votre pouvoir, dans le sens : quelles sont les capacités que Dieu a déposées en vous et quel est votre génie propre ?
Il ne faudrait pas que orgueil nous oblige à faire de l’homme un modèle pour la femme, un modèle qu’il faudrait égaler, car homme et femme ont tous deux même modèle, Dieu, qui n’est ni un homme ni une femme. Et ce que Dieu veut, c’est l’épanouissement de chacun de ses enfants, plutôt qu’une équation sociale.
Tournons vers la Vierge Marie, accomplissement éminent d’une vocation, avec les mots du même Jean-Paul II dans Redemptoris Missio :
Toute l'Eglise est invitée à vivre plus intensément le mystère du Christ, en collaborant dans l'action de grâce à l'œuvre du salut. Elle le fait avec Marie et comme Marie, sa mère et son modèle. Marie est le modèle de l'amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Eglise, travaillent à la régénération des hommes. C'est pourquoi, « soutenue par la présence du Christ [...], l'Eglise marche au cours du temps vers la consommation des siècles et va à la rencontre du Seigneur qui vient; mais sur ce chemin [...], elle progresse en suivant l'itinéraire accompli par la Vierge Marie »177.
C'est à la « médiation de Marie, tout orientée vers le Christ et tendue vers la révélation de sa puissance salvifique »178, que je confie l'Eglise et en particulier ceux qui se consacrent à la mise en œuvre du précepte missionnaire dans le monde d'aujourd'hui"
P. Emmanuel d'Andigné
BONUS ! Voici le texte intégral du texte de Jean-Paul II sur l'ordination réservée aux hommes
LETTRE APOSTOLIQUEORDINATIO SACERDOTALIS DU PAPE JEAN-PAUL IISUR L'ORDINATION SACERDOTALEEXCLUSIVEMENT RÉSERVÉEAUX HOMMES
Vénérables Frères dans l'épiscopat,
1. L'ordination sacerdotale, par laquelle est transmise la charge, confiée par le Christ à ses Apôtres, d'enseigner, de sanctifier et de gouverner les fidèles, a toujours été, dans l'Église catholique depuis l'origine, exclusivement réservée à des hommes. Les Églises d'Orient ont, elles aussi, fidèlement conservé cette tradition.
Lorsque, dans la Communion anglicane, fut soulevée la question de l'ordination des femmes, le Pape Paul VI, fidèle à sa charge de gardien de la Tradition apostolique et désireux de lever un nouvel obstacle placé sur le chemin qui mène à l'unité des chrétiens, rappela à ses frères anglicans la position de l'Église catholique: «Celle-ci tient que l'ordination sacerdotale des femmes ne saurait être acceptée, pour des raisons tout à fait fondamentales. Ces raisons sont notamment: l'exemple, rapporté par la Sainte Écriture, du Christ qui a choisi ses Apôtres uniquement parmi les hommes; la pratique constante de l'Église qui a imité le Christ en ne choisissant que des hommes; et son magistère vivant qui, de manière continue, a soutenu que l'exclusion des femmes du sacerdoce est en accord avec le plan de Dieu sur l'Église»(1).
Mais, la question ayant été débattue même parmi les théologiens et dans certains milieux catholiques, le Pape Paul VI demanda à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi d'exposer et de clarifier la doctrine de l'Église sur ce point. Ce fut l'objet de la Déclaration Inter insigniores, que le Pape lui-même approuva et ordonna de publier(2).
2. La Déclaration reprend et développe les fondements de cette doctrine, exposés par Paul VI, et conclut que l'Église «ne se considère pas autorisée à admettre les femmes à l'ordination sacerdotale»(3). À ces raisons fondamentales, le même document ajoute d'autres raisons théologiques qui mettent en lumière la convenance de cette disposition divine et il montre clairement que la pratique suivie par le Christ n'obéissait pas à des motivations sociologiques ou culturelles propres à son temps. Comme le précisa plus tard le Pape Paul VI, «la véritable raison est que le Christ en a disposé ainsi lorsqu'il a donné à l'Église sa constitution fondamentale et l'anthropologie théologique qui a toujours été observée ensuite par la Tradition de cette même Église»(4).
Dans la Lettre apostolique Mulieris dignitatem, j'ai moi-même écrit à ce sujet: «En n'appelant que des hommes à être ses Apôtres, le Christ a agi d'une manière totalement libre et souveraine. Il l'a fait dans la liberté même avec laquelle il a mis en valeur la dignité et la vocation de la femme par tout son comportement, sans se conformer aux usages qui prévalaient ni aux traditions que sanctionnait la législation de son époque»(5).
En effet, les Évangiles et les Actes des Apôtres montrent bien que cet appel s'est fait selon le dessein éternel de Dieu: le Christ a choisi ceux qu'il voulait (cf. Mc 3,13-14; Jn 6,70) et il l'a fait en union avec le Père, «par l'Esprit Saint» (Ac 1,2), après avoir passé la nuit en prière (cf. Lc 6,12). C'est pourquoi, pour l'admission au sacerdoce ministériel(6), l'Église a toujours reconnu comme norme constante la manière d'agir de son Seigneur dans le choix des douze hommes dont il a fait le fondement de son Église (cf. Ap 21,14). Et ceux-ci n'ont pas seulement reçu une fonction qui aurait pu ensuite être exercée par n'importe quel membre de l'Église, mais ils ont été spécialement et intimement associés à la mission du Verbe incarné lui-même (cf. Mt 10,1.7-8; 28,16-20; Mc 3,13-16; 16,14-15). Les Apôtres ont fait de même lorsqu'ils ont choisi leurs collaborateurs(7), qui devaient leur succéder dans le ministère(8). Dans ce choix se trouvaient inclus ceux qui, dans le temps de l'Église, continueraient la mission confiée aux Apôtres de représenter le Christ Seigneur et Rédempteur(9).
3. D'autre part, le fait que la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, n'ait reçu ni la mission spécifique des Apôtres ni le sacerdoce ministériel montre clairement que la non-admission des femmes à l'ordination sacerdotale ne peut pas signifier qu'elles auraient une dignité moindre ni qu'elles seraient l'objet d'une discrimination; mais c'est l'observance fidèle d'une disposition qu'il faut attribuer à la sagesse du Seigneur de l'univers.
La présence et le rôle de la femme dans la vie et dans la mission de l'Église, bien que non liés au sacerdoce ministériel, demeurent absolument nécessaires et irremplaçables. Comme l'a observé la Déclaration Inter insigniores, «l'Église souhaite que les femmes chrétiennes prennent pleinement conscience de la grandeur de leur mission: leur rôle sera capital aujourd'hui, aussi bien pour le renouvellement et l'humanisation de la société que pour la redécouverte, parmi les croyants, du vrai visage de l'Église»(10). Le Nouveau Testament et l'ensemble de l'histoire de l'Église montre abondamment la présence, dans l'Église, de femmes qui furent de véritables disciples et témoins du Christ, dans leurs familles et dans leurs professions civiles, ainsi que dans la consécration totale au service de Dieu et de l'Évangile. «L'Église, en effet, en défendant la dignité de la femme et sa vocation, a manifesté de la gratitude à celles qui, fidèles à l'Évangile, ont participé en tout temps à la mission apostolique de tout le Peuple de Dieu, et elle les a honorées. Il s'agit de saintes martyres, de vierges, de mères de famille qui ont témoigné de leur foi avec courage et qui, par l'éducation de leurs enfants dans l'esprit de l'Évangile, ont transmis la foi et la tradition de l'Église»(11).
D'autre part, c'est à la sainteté des fidèles que se trouve totalement ordonnée la structure hiérarchique de l'Église. Voilà pourquoi, rappelle la Déclaration Inter insigniores, «le seul charisme supérieur, qui peut et doit être désiré, c'est la charité (cf. 1 Co 12-13). Les plus grands dans le Royaume des Cieux, ce ne sont pas les ministres, mais les saints»(12).
4. Bien que la doctrine sur l'ordination sacerdotale exclusivement réservée aux hommes ait été conservée par la Tradition constante et universelle de l'Église et qu'elle soit fermement enseignée par le Magistère dans les documents les plus récents, de nos jours, elle est toutefois considérée de différents côtés comme ouverte au débat, ou même on attribue une valeur purement disciplinaire à la position prise par l'Église de ne pas admettre les femmes à l'ordination sacerdotale.
C'est pourquoi, afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l'Église, je déclare, en vertu de ma mission de confirmer mes frères (cf. Lc 22,32), que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église.
Priant pour vous, Vénérables Frères, et pour tout le peuple chrétien, afin que vous receviez constamment l'aide divine, j'accorde à tous la Bénédiction apostolique.
Du Vatican, le 22 mai 1994, solennité de la Pentecôte, en la seizième année de mon pontificat.
(1) Cf. PAUL VI, Réponse à la lettre de Sa Grâce le Très Révérend Dr Frederick Donald Coggan, Archevêque de Cantorbery, sur le ministère sacerdotal des femmes, 30 novembre 1975: AAS 68 (1976), pp. 599-600: «Your Grace is of course well aware of the Catholic Church's position on this question. She holds that it is not admissible to ordain women to the priesthood, for very fundamental reasons. These reasons include: the example recorded in the Sacred Scriptures of Christ choosing his Apostles only from among men; the constant practice of the Church, which has imitated Christ in choosing only men; and her living teaching authority which has consistently held that the exclusion of women from the priesthood is in accordance with God's plan for his Church» (p. 599).Vénérables Frères dans l'épiscopat,
1. L'ordination sacerdotale, par laquelle est transmise la charge, confiée par le Christ à ses Apôtres, d'enseigner, de sanctifier et de gouverner les fidèles, a toujours été, dans l'Église catholique depuis l'origine, exclusivement réservée à des hommes. Les Églises d'Orient ont, elles aussi, fidèlement conservé cette tradition.
Lorsque, dans la Communion anglicane, fut soulevée la question de l'ordination des femmes, le Pape Paul VI, fidèle à sa charge de gardien de la Tradition apostolique et désireux de lever un nouvel obstacle placé sur le chemin qui mène à l'unité des chrétiens, rappela à ses frères anglicans la position de l'Église catholique: «Celle-ci tient que l'ordination sacerdotale des femmes ne saurait être acceptée, pour des raisons tout à fait fondamentales. Ces raisons sont notamment: l'exemple, rapporté par la Sainte Écriture, du Christ qui a choisi ses Apôtres uniquement parmi les hommes; la pratique constante de l'Église qui a imité le Christ en ne choisissant que des hommes; et son magistère vivant qui, de manière continue, a soutenu que l'exclusion des femmes du sacerdoce est en accord avec le plan de Dieu sur l'Église»(1).
Mais, la question ayant été débattue même parmi les théologiens et dans certains milieux catholiques, le Pape Paul VI demanda à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi d'exposer et de clarifier la doctrine de l'Église sur ce point. Ce fut l'objet de la Déclaration Inter insigniores, que le Pape lui-même approuva et ordonna de publier(2).
2. La Déclaration reprend et développe les fondements de cette doctrine, exposés par Paul VI, et conclut que l'Église «ne se considère pas autorisée à admettre les femmes à l'ordination sacerdotale»(3). À ces raisons fondamentales, le même document ajoute d'autres raisons théologiques qui mettent en lumière la convenance de cette disposition divine et il montre clairement que la pratique suivie par le Christ n'obéissait pas à des motivations sociologiques ou culturelles propres à son temps. Comme le précisa plus tard le Pape Paul VI, «la véritable raison est que le Christ en a disposé ainsi lorsqu'il a donné à l'Église sa constitution fondamentale et l'anthropologie théologique qui a toujours été observée ensuite par la Tradition de cette même Église»(4).
Dans la Lettre apostolique Mulieris dignitatem, j'ai moi-même écrit à ce sujet: «En n'appelant que des hommes à être ses Apôtres, le Christ a agi d'une manière totalement libre et souveraine. Il l'a fait dans la liberté même avec laquelle il a mis en valeur la dignité et la vocation de la femme par tout son comportement, sans se conformer aux usages qui prévalaient ni aux traditions que sanctionnait la législation de son époque»(5).
En effet, les Évangiles et les Actes des Apôtres montrent bien que cet appel s'est fait selon le dessein éternel de Dieu: le Christ a choisi ceux qu'il voulait (cf. Mc 3,13-14; Jn 6,70) et il l'a fait en union avec le Père, «par l'Esprit Saint» (Ac 1,2), après avoir passé la nuit en prière (cf. Lc 6,12). C'est pourquoi, pour l'admission au sacerdoce ministériel(6), l'Église a toujours reconnu comme norme constante la manière d'agir de son Seigneur dans le choix des douze hommes dont il a fait le fondement de son Église (cf. Ap 21,14). Et ceux-ci n'ont pas seulement reçu une fonction qui aurait pu ensuite être exercée par n'importe quel membre de l'Église, mais ils ont été spécialement et intimement associés à la mission du Verbe incarné lui-même (cf. Mt 10,1.7-8; 28,16-20; Mc 3,13-16; 16,14-15). Les Apôtres ont fait de même lorsqu'ils ont choisi leurs collaborateurs(7), qui devaient leur succéder dans le ministère(8). Dans ce choix se trouvaient inclus ceux qui, dans le temps de l'Église, continueraient la mission confiée aux Apôtres de représenter le Christ Seigneur et Rédempteur(9).
3. D'autre part, le fait que la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, n'ait reçu ni la mission spécifique des Apôtres ni le sacerdoce ministériel montre clairement que la non-admission des femmes à l'ordination sacerdotale ne peut pas signifier qu'elles auraient une dignité moindre ni qu'elles seraient l'objet d'une discrimination; mais c'est l'observance fidèle d'une disposition qu'il faut attribuer à la sagesse du Seigneur de l'univers.
La présence et le rôle de la femme dans la vie et dans la mission de l'Église, bien que non liés au sacerdoce ministériel, demeurent absolument nécessaires et irremplaçables. Comme l'a observé la Déclaration Inter insigniores, «l'Église souhaite que les femmes chrétiennes prennent pleinement conscience de la grandeur de leur mission: leur rôle sera capital aujourd'hui, aussi bien pour le renouvellement et l'humanisation de la société que pour la redécouverte, parmi les croyants, du vrai visage de l'Église»(10). Le Nouveau Testament et l'ensemble de l'histoire de l'Église montre abondamment la présence, dans l'Église, de femmes qui furent de véritables disciples et témoins du Christ, dans leurs familles et dans leurs professions civiles, ainsi que dans la consécration totale au service de Dieu et de l'Évangile. «L'Église, en effet, en défendant la dignité de la femme et sa vocation, a manifesté de la gratitude à celles qui, fidèles à l'Évangile, ont participé en tout temps à la mission apostolique de tout le Peuple de Dieu, et elle les a honorées. Il s'agit de saintes martyres, de vierges, de mères de famille qui ont témoigné de leur foi avec courage et qui, par l'éducation de leurs enfants dans l'esprit de l'Évangile, ont transmis la foi et la tradition de l'Église»(11).
D'autre part, c'est à la sainteté des fidèles que se trouve totalement ordonnée la structure hiérarchique de l'Église. Voilà pourquoi, rappelle la Déclaration Inter insigniores, «le seul charisme supérieur, qui peut et doit être désiré, c'est la charité (cf. 1 Co 12-13). Les plus grands dans le Royaume des Cieux, ce ne sont pas les ministres, mais les saints»(12).
4. Bien que la doctrine sur l'ordination sacerdotale exclusivement réservée aux hommes ait été conservée par la Tradition constante et universelle de l'Église et qu'elle soit fermement enseignée par le Magistère dans les documents les plus récents, de nos jours, elle est toutefois considérée de différents côtés comme ouverte au débat, ou même on attribue une valeur purement disciplinaire à la position prise par l'Église de ne pas admettre les femmes à l'ordination sacerdotale.
C'est pourquoi, afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l'Église, je déclare, en vertu de ma mission de confirmer mes frères (cf. Lc 22,32), que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église.
Priant pour vous, Vénérables Frères, et pour tout le peuple chrétien, afin que vous receviez constamment l'aide divine, j'accorde à tous la Bénédiction apostolique.
Du Vatican, le 22 mai 1994, solennité de la Pentecôte, en la seizième année de mon pontificat.
(2) Cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Déclaration Inter insigniores sur la question de l'admission des femmes au sacerdoce ministériel, 15 octobre 1976: AAS 69 (1977), pp. 98-116.
(3) Ibid., p. 100.
(4) PAUL VI, Allocution Il ruolo della donna nel disegno di Dio, 30 janvier 1977: Insegnamenti, vol. XV, 1977, p. 111. Cf. aussi JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique Christifideles laici, 30 décembre 1988, n. 51: AAS 81 (1989), pp. 393-521; Catéchisme de l'Église catholique, n. 1577.
(5) Lettre apostolique Mulieris dignitatem, 15 août 1988, n. 26: AAS 80 (1988), p. 1715
(6) Cf. Const. dogm. Lumen gentium, n. 28; Décret Presbyterorum ordinis, n. 2.
(7) Cf. 1 Tm 3,1-13; 2 Tm 1,6; Tt 1,5-9.
(8) Cf. Catéchisme de l'Église catholique, n. 1577.
(9) Cf. Const. dogm. Lumen gentium, nn. 20-21.
(10) CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Déclaration Inter insigniores, n. 6: AAS 69 (1977), pp. 115-116
(11) Lettre apostolique Mulieris dignitatem, n. 27: AAS 80 (1988), p. 1719
(12) CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Déclaration Inter insigniores, n. 6: AAS 69 (1977), p. 115
18 octobre 2009
Homélie du 11 octobre 2009
Homélie du 28ème dimanche du Temps ordinaire - Année B
Tout d’abord, je souhaiterais vous faire part d’une initiative fort intéressante pour laquelle j’ai été sollicité : il s’agit du « week-end des parrains ». Le principe est simple : on invite pendant un week-end les parrains et marraines des enfants, et au cours de ce week-end, qui est fait surtout de retrouvailles et de détente, on demande à un prêtre de nourrir la conversation du déjeuner du dimanche !!! Avis aux amateurs …
De loin, les lectures d’aujourd’hui donnent l’impression de n’être qu’une « charge » contre la richesse ou les riches … nous sommes en effet assez idéologues, et nous sommes tentés de faire à propos de ces textes une lecture de droite (c’est pas ce qu’il a voulu dire, rassurez-vous), ou alors « de gauche » (on vous exploite, les pauvres ! Révoltez-vous !) ; je souhaiterais, plutôt faire un commentaire spirituel, c’est à dire selon l’Esprit de Dieu. « Spirituel » ne signifie pas désincarné, car les conséquences pratiques ne tardent pas à venir après un tel commentaire. Laissons-nous donc enseigner par Dieu et l’Eglise.
De plus près, donc, le livre de la Sagesse et la Bible en général présentent plutôt l’argent et la réussite comme un signe de bénédiction … c’est la raison pour laquelle les apôtre sont si surpris quand Jésus parle de la difficulté des riches à entrer dans le Royaume !!!
En fait, le livre de la Sagesse se livre à une remise en ordre des priorités, à partir de l’argent que tout le monde considère avec respect et dont tout le monde perçoit l’importance, avec la santé la lumière et la beauté qui sont aussi de bonnes choses pourvu qu’on ne les divinise pas. Nous sommes évidemment en présence d’une provocation, très efficace en raison des « ressorts » choisis.
Provocation, aussi, dans l’Evangile, à la manière d’un « si ta main te conduit au péché, coupe-la !.. Car il est fort probable que vous n’allez pas appliquer l’Evangile d’aujourd’hui à la lettre, en vendant tout ce que vous avez, quoi que si vous y tenez, souvenez-vous qu’on peut toujours faire un don ou un legs à une paroisse …
Cette provocation n’est pas inutile, car il est en effet très difficile de posséder de l’argent sans que celui-ci vous possède. C’est donc purifiant pour le rapport à l’argent et efficace comme dans le livre de la Sagesse, afin de remettre en ordre sa vie.
C’est la preuve du réalisme de Jésus, qui connaît bien la nature humaine et traite de toutes les questions avec liberté, sans se dire « aië, aïe aïe, je vais me fait mal voir par cette catégorie de gens »
« Je veille à ne choquer personne en rien afin de ne pas exposer mon ministère à la critique », disait simplement St Paul (2 cor 6), puisque ni lui ni nous ne sommes Jésus.
De tout cela je voudrais tirer deux suggestions, sous forme d’une invitation à la lecture … avez-vous lu ces deux ouvrages ?
Le Manuel de survie de la mère de famille, qui fut écrit par l’une d’elles et qui invite à hiérarchiser les priorités pour rechercher la sainteté, en s’inspirant de ceux qui quittent tout. Et cela donne à titre d’exemple : Dieu, moi, mon mari, mes enfants et le reste …
L’Encyclique Veritatis Splendor de Jean-Paul II, dont la base est Mt 19, le parallèle de l’Evangile d’aujourd’hui : vous y trouverez un commentaire plus complet de cette rencontre lumineuse entre Jésus et « le jeune homme riche ».
Pour vous mettre en appétit, voici deux ou trois remarques du pape.
- l’homme n’est pas nommé dans cette rencontre, nous pouvons tous nous reconnaître en lui.
- « L'interlocuteur de Jésus pressent qu'il existe un lien entre le bien moral et le plein accomplissement de sa destinée personnelle », ce qui donne immédiatement une profondeur et un intérêt à la morale catholique.
- Tout se base sur la rencontre avec Dieu par le Christ
En fait, ce passage est proposé par Jean-Paul II comme la base de tout le discours moral de l’Eglise. Nous en avons pas mal parlé en prédication et en catéchèse adulte, je n’insiste pas … Voici simplement comment se termine l’encyclique, emplie non seulement d’un véritable enseignement, mais aussi d’un vrai souffle spirituel, voyez plutôt :
La Sagesse, c'est Jésus Christ lui-même, le Verbe éternel de Dieu, qui révèle et accomplit parfaitement la volonté du Père (cf. He 10, 5-10). Marie invite tout homme à accueillir cette Sagesse. C'est à nous aussi qu'elle adresse l'ordre donné aux serviteurs, à Cana de Galilée, durant le repas de noces : « Faites tout ce qu'il vous dira » (Jn 2, 5).
Marie partage notre condition humaine, mais dans une transparence totale à la grâce de Dieu. N'ayant pas connu le péché, elle est en mesure de compatir à toute faiblesse. Elle comprend l'homme pécheur et elle l'aime d'un amour maternel. Voilà pourquoi elle est du côté de la vérité et partage le fardeau de l'Eglise dans son rappel des exigences morales à tous et en tout temps. Pour la même raison, elle n'accepte pas que l'homme pécheur soit trompé par quiconque prétendrait l'aimer en justifiant son péché, car elle sait qu'ainsi le sacrifice du Christ, son Fils, serait rendu inutile. Aucun acquittement, fût-il prononcé par des doctrines philosophiques ou théologiques complaisantes, ne peut rendre l'homme véritablement heureux : seules la Croix et la gloire du Christ ressuscité peuvent pacifier sa conscience et sauver sa vie.
P. Emmanuel d'Andigné
De loin, les lectures d’aujourd’hui donnent l’impression de n’être qu’une « charge » contre la richesse ou les riches … nous sommes en effet assez idéologues, et nous sommes tentés de faire à propos de ces textes une lecture de droite (c’est pas ce qu’il a voulu dire, rassurez-vous), ou alors « de gauche » (on vous exploite, les pauvres ! Révoltez-vous !) ; je souhaiterais, plutôt faire un commentaire spirituel, c’est à dire selon l’Esprit de Dieu. « Spirituel » ne signifie pas désincarné, car les conséquences pratiques ne tardent pas à venir après un tel commentaire. Laissons-nous donc enseigner par Dieu et l’Eglise.
De plus près, donc, le livre de la Sagesse et la Bible en général présentent plutôt l’argent et la réussite comme un signe de bénédiction … c’est la raison pour laquelle les apôtre sont si surpris quand Jésus parle de la difficulté des riches à entrer dans le Royaume !!!
En fait, le livre de la Sagesse se livre à une remise en ordre des priorités, à partir de l’argent que tout le monde considère avec respect et dont tout le monde perçoit l’importance, avec la santé la lumière et la beauté qui sont aussi de bonnes choses pourvu qu’on ne les divinise pas. Nous sommes évidemment en présence d’une provocation, très efficace en raison des « ressorts » choisis.
Provocation, aussi, dans l’Evangile, à la manière d’un « si ta main te conduit au péché, coupe-la !.. Car il est fort probable que vous n’allez pas appliquer l’Evangile d’aujourd’hui à la lettre, en vendant tout ce que vous avez, quoi que si vous y tenez, souvenez-vous qu’on peut toujours faire un don ou un legs à une paroisse …
Cette provocation n’est pas inutile, car il est en effet très difficile de posséder de l’argent sans que celui-ci vous possède. C’est donc purifiant pour le rapport à l’argent et efficace comme dans le livre de la Sagesse, afin de remettre en ordre sa vie.
C’est la preuve du réalisme de Jésus, qui connaît bien la nature humaine et traite de toutes les questions avec liberté, sans se dire « aië, aïe aïe, je vais me fait mal voir par cette catégorie de gens »
« Je veille à ne choquer personne en rien afin de ne pas exposer mon ministère à la critique », disait simplement St Paul (2 cor 6), puisque ni lui ni nous ne sommes Jésus.
De tout cela je voudrais tirer deux suggestions, sous forme d’une invitation à la lecture … avez-vous lu ces deux ouvrages ?
Le Manuel de survie de la mère de famille, qui fut écrit par l’une d’elles et qui invite à hiérarchiser les priorités pour rechercher la sainteté, en s’inspirant de ceux qui quittent tout. Et cela donne à titre d’exemple : Dieu, moi, mon mari, mes enfants et le reste …
L’Encyclique Veritatis Splendor de Jean-Paul II, dont la base est Mt 19, le parallèle de l’Evangile d’aujourd’hui : vous y trouverez un commentaire plus complet de cette rencontre lumineuse entre Jésus et « le jeune homme riche ».
Pour vous mettre en appétit, voici deux ou trois remarques du pape.
- l’homme n’est pas nommé dans cette rencontre, nous pouvons tous nous reconnaître en lui.
- « L'interlocuteur de Jésus pressent qu'il existe un lien entre le bien moral et le plein accomplissement de sa destinée personnelle », ce qui donne immédiatement une profondeur et un intérêt à la morale catholique.
- Tout se base sur la rencontre avec Dieu par le Christ
En fait, ce passage est proposé par Jean-Paul II comme la base de tout le discours moral de l’Eglise. Nous en avons pas mal parlé en prédication et en catéchèse adulte, je n’insiste pas … Voici simplement comment se termine l’encyclique, emplie non seulement d’un véritable enseignement, mais aussi d’un vrai souffle spirituel, voyez plutôt :
La Sagesse, c'est Jésus Christ lui-même, le Verbe éternel de Dieu, qui révèle et accomplit parfaitement la volonté du Père (cf. He 10, 5-10). Marie invite tout homme à accueillir cette Sagesse. C'est à nous aussi qu'elle adresse l'ordre donné aux serviteurs, à Cana de Galilée, durant le repas de noces : « Faites tout ce qu'il vous dira » (Jn 2, 5).
Marie partage notre condition humaine, mais dans une transparence totale à la grâce de Dieu. N'ayant pas connu le péché, elle est en mesure de compatir à toute faiblesse. Elle comprend l'homme pécheur et elle l'aime d'un amour maternel. Voilà pourquoi elle est du côté de la vérité et partage le fardeau de l'Eglise dans son rappel des exigences morales à tous et en tout temps. Pour la même raison, elle n'accepte pas que l'homme pécheur soit trompé par quiconque prétendrait l'aimer en justifiant son péché, car elle sait qu'ainsi le sacrifice du Christ, son Fils, serait rendu inutile. Aucun acquittement, fût-il prononcé par des doctrines philosophiques ou théologiques complaisantes, ne peut rendre l'homme véritablement heureux : seules la Croix et la gloire du Christ ressuscité peuvent pacifier sa conscience et sauver sa vie.
Homélie du 04 octobre 2009
Homélie du 27ème dimanche du temps Ordinaire - Année B
Toutes les lectures de cette messe ont un rapport avec la famille, sa grandeur et sa dignité. « L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un », nous disait le livre de la Genèse. « Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier », poursuivait le psaume 127. « Jésus, qui sanctifie les hommes, n’a pas honte de les appeler ses frères », ajoute la lettre aux hébreux. Et l’Evangile selon saint Marc, après avoir rappelé le texte de la genèse, nous parle des enfants : « laissez venir à moi les petites enfants, répond vivement Jésus à ses disciples.
Il est donc aujourd’hui tout d’abord indiqué de rendre grâce au Seigneur pour la création. « Le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes de champs et tous les oiseaux du ciel … c’était des êtres vivants ».
Puis il créa l’homme et la femme. Il mit un grand amour de l’un pour l’autre. On a tellement tendance à s’arrêter à tout ce qui contrarie le dessein de Dieu qu’on peut le louer pour la grandeur et la beauté de son œuvre.
Bien sûr, le récit des premières pages de la Bible n’est pas à prendre au sens scientifique et historique, tel qu’on l’entend aujourd’hui. Mais dans son apparente naïveté, il renferme des vérités fondamentales.
Le monde est l’œuvre d’un Dieu bon qui a créé de la beauté, qui a voulu que des êtres, à son image, vivent dans l’amour, dans le bonheur, dans la liberté guidée par l’amour.
Disons notre reconnaissance à Dieu pour tous ceux et celles qui nous ont transmis la vie et les valeurs essentielles d’une existence harmonieuse et paisible, nos parents en premier lieu, nos ancêtres et toutes les personnes qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à notre bien. On se réjouit de voir des jeunes qui s’aiment s’orienter vers le mariage. La lettre aux hébreux nous ouvre à des horizons beaucoup plus vastes, quoique mystérieux : celui qui est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, a été abaissé un peu au-dessous des anges. Lui qui est à l’origine du salut de tous, il a accepté de connaître la souffrance, la passion très douloureuse et la mort, et cela pour conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire.
Ainsi, « Jésus qui sanctifie, et les hommes qui sont sanctifiés, sont de la même race. » Jésus confie à l’homme une dignité incroyable, au point de l’appeler « son frère ». L’homme doit donc répondre à cet immense privilège. C’est ce que chante le psaume : « heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ».
Il aura à se nourrir du travail de ses mains. Sa femme collaborera activement dans la maison pour réunir ses fils autour d’une table généreuse. « Voilà comment sera béni celui qui craint le Seigneur ». L’idéal est ainsi exprimé. Et le verset de l’alleluia l’explicite : « « Si nous demeurons dans l’amour, nous demeurons en Dieu : Dieu est amour ».
Mais l’Evangile aborde tout de suite les difficultés. L’harmonie du couple peut se détériorer. La tentation de rupture guette ceux qui s’aimaient sincèrement. Jésus rappelle que, si Moïse a consenti certaines permissions, c’est à cause de l’endurcissement du cœur. Mais au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme… ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu’un. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! ». L’Evangile se poursuit avec la scène concernant les enfants que l’on présentait à Jésus, alors que les disciples les écartaient sans ménagement.
Il se trouve que ces jours-ci, la liturgie est revenue à plusieurs reprise sur les enfants. Jeudi, en la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, l’Evangile selon saint Matthieu répondait à la question : « qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? ». Jésus plaça un petit enfant au milieu de ses disciples et il déclara : « « si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux … Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c’est moi qu’il accueille. »
Le lendemain, 02 octobre, en la fête des saints Anges Gardiens, Jésus nous redisait : « Celui qui se fera petit comme cet enfant, c’est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux … gardez-vous de mépriser u seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon père qui est au cieux. »
Ces remarques de Jésus devraient avoir d’autant plus de relief que la société de l’époque n’accordait guère d’importance aux enfants et les maintenait dans un état de complète dépendance.
Ce que Jésus nous donne en exemple ici, c’est la disponibilité, la confiance, l’obéissance simple et spontanée de l’enfant qui se sent aimé.
En la fête de Saint François d’Assise, demandons-lui de nous faire partager son esprit d’admiration pour la nature et de louange à son Créateur. Amen.
Il est donc aujourd’hui tout d’abord indiqué de rendre grâce au Seigneur pour la création. « Le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes de champs et tous les oiseaux du ciel … c’était des êtres vivants ».
Puis il créa l’homme et la femme. Il mit un grand amour de l’un pour l’autre. On a tellement tendance à s’arrêter à tout ce qui contrarie le dessein de Dieu qu’on peut le louer pour la grandeur et la beauté de son œuvre.
Bien sûr, le récit des premières pages de la Bible n’est pas à prendre au sens scientifique et historique, tel qu’on l’entend aujourd’hui. Mais dans son apparente naïveté, il renferme des vérités fondamentales.
Le monde est l’œuvre d’un Dieu bon qui a créé de la beauté, qui a voulu que des êtres, à son image, vivent dans l’amour, dans le bonheur, dans la liberté guidée par l’amour.
Disons notre reconnaissance à Dieu pour tous ceux et celles qui nous ont transmis la vie et les valeurs essentielles d’une existence harmonieuse et paisible, nos parents en premier lieu, nos ancêtres et toutes les personnes qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à notre bien. On se réjouit de voir des jeunes qui s’aiment s’orienter vers le mariage. La lettre aux hébreux nous ouvre à des horizons beaucoup plus vastes, quoique mystérieux : celui qui est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, a été abaissé un peu au-dessous des anges. Lui qui est à l’origine du salut de tous, il a accepté de connaître la souffrance, la passion très douloureuse et la mort, et cela pour conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire.
Ainsi, « Jésus qui sanctifie, et les hommes qui sont sanctifiés, sont de la même race. » Jésus confie à l’homme une dignité incroyable, au point de l’appeler « son frère ». L’homme doit donc répondre à cet immense privilège. C’est ce que chante le psaume : « heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ».
Il aura à se nourrir du travail de ses mains. Sa femme collaborera activement dans la maison pour réunir ses fils autour d’une table généreuse. « Voilà comment sera béni celui qui craint le Seigneur ». L’idéal est ainsi exprimé. Et le verset de l’alleluia l’explicite : « « Si nous demeurons dans l’amour, nous demeurons en Dieu : Dieu est amour ».
Mais l’Evangile aborde tout de suite les difficultés. L’harmonie du couple peut se détériorer. La tentation de rupture guette ceux qui s’aimaient sincèrement. Jésus rappelle que, si Moïse a consenti certaines permissions, c’est à cause de l’endurcissement du cœur. Mais au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme… ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu’un. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! ». L’Evangile se poursuit avec la scène concernant les enfants que l’on présentait à Jésus, alors que les disciples les écartaient sans ménagement.
Il se trouve que ces jours-ci, la liturgie est revenue à plusieurs reprise sur les enfants. Jeudi, en la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, l’Evangile selon saint Matthieu répondait à la question : « qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? ». Jésus plaça un petit enfant au milieu de ses disciples et il déclara : « « si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux … Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c’est moi qu’il accueille. »
Le lendemain, 02 octobre, en la fête des saints Anges Gardiens, Jésus nous redisait : « Celui qui se fera petit comme cet enfant, c’est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux … gardez-vous de mépriser u seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon père qui est au cieux. »
Ces remarques de Jésus devraient avoir d’autant plus de relief que la société de l’époque n’accordait guère d’importance aux enfants et les maintenait dans un état de complète dépendance.
Ce que Jésus nous donne en exemple ici, c’est la disponibilité, la confiance, l’obéissance simple et spontanée de l’enfant qui se sent aimé.
En la fête de Saint François d’Assise, demandons-lui de nous faire partager son esprit d’admiration pour la nature et de louange à son Créateur. Amen.
P. Jean Rouillard
Inscription à :
Articles (Atom)